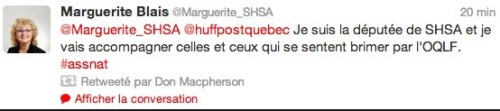«On a tous notre heure de gloire
On a tous écrit une page
Du grand livre d’histoire
D’une ligue de garage»
Éric Lapointe, «Rocket (On est tous des Maurice Richard)», 1998
Bâton élevé, mises en échec verbales et slapshots philosophiques, qu’a publié récemment Sébastien Raymond, fait se rejoindre deux façons de concevoir le hockey de plus en plus visibles dans la société québécoise.
Depuis quelques années, on a étudié le «sport national» à partir de la théologie (Bauer et Barrot, 2009; Bauer, 2011), de l’histoire culturelle (l’Oreille tendue, 2006), de la psychologie (Grondin, 2012), des sciences humaines en général (Laurin-Lamothe et Moreau, 2011) — et de la philosophie (Baillargeon et Boissinot, 2009).
Dans le même temps, il a été beaucoup question, notamment dans la culture populaire, des ligues de garage. Le meilleur exemple de cela est la série de films, puis d’émissions de télévision, les Boys.
Qu’est-ce qu’une ligue de garage ? La définition suivante est proposée par un des ailiers droits du Patriote de la Vieille Capitale, par ailleurs fidèle lecteur de l’Oreille tendue :
une organisation dont les équipes sont formées de mécaniciens (d’où vient son nom, je suppose), de travailleurs de la construction, de couvreurs, d’électriciens, de commis bancaires, de profs de français ou de philo. Trois particularités dans ce genre d’organisation : les noms d’équipes anglais y sont légion (c’est plus sérieux… encore que Angry Beavers), les matchs ont lieu à des heures impossibles et il faut payer pour y jouer (les lock-out sont peu probables).
Il n’est dès lors pas très étonnant de voir aujourd’hui paraître un ouvrage cherchant, dans ce type de hockey, des «slapshots philosophiques». (Slap Shot n’est seulement un titre de film; c’est aussi un type de lancer, le «lancer frappé».)
En quatrième de couverture, on dit de l’ouvrage qu’il «s’intéresse à l’un des aspects les plus emblématiques de la société québécoise» et qu’il est constitué «de citations glanées dans les chambres de joueurs» et de «photographies originales». Il s’agirait de poser «un regard artistique et plein d’humour sur l’univers des ligues de garage», de montrer comment «la testostérone et la philosophie font bon ménage».
L’entreprise est cependant bien décevante. Sauf exception («Moi, je me considère en bonne forme, malgré que je sois petit pour mon âge»), les «textes» restent au ras des pâquerettes et beaucoup de photos souffrent de leur composition sur deux pages (le lecteur n’arrive pas à voir le centre de l’image). D’autres sont sous-éclairées ou floues.
Les joueurs cités ou photographiés seront peut-être contents du livre. Les autres, pas. L’analyse philosophique des ligues de garage reste à faire. (Il est vrai que ce n’était pas le but de Sébastien Raymond.)
P.-S. — Interrogation linguistique. Dans la phrase «À 5’9” et 175 livres mouillées, tu rentres pas trop fort dans le lard d’un gars qui pèse 50 livres de plus que toi et à qui tu passes en dessous des épaules…», l’accord de «mouillées» attire le regard. Des «livres mouillées» ? L’Oreille tendue aurait préféré le masculin singulier : c’est le joueur dont il est question implicitement qui est «mouillé», pas les livres qu’il pèse.
Références
Baillargeon, Normand et Christian Boissinot (édit.), la Vraie Dureté du mental. Hockey et philosophie, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université Laval, coll. «Quand la philosophie fait pop !», 2009, xiii/262 p. Ill. Préface de Jean Dion.
Bauer, Olivier et Jean-Marc Barreau (édit.), la Religion du Canadien de Montréal, Montréal, Fides, 2009, 182 p. Ill.
Bauer, Olivier, Une théologie du Canadien de Montréal, Montréal, Bayard Canada, coll. «Religions et société», 2011, 214 p. Ill.
Grondin, Simon, le Hockey vu du divan, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université Laval, 2012, 214 p. Ill.
Laurin-Lamothe, Audrey et Nicolas Moreau (édit.), le Canadien de Montréal. Une légende repensée, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2011, 144 p.
Melançon, Benoît, les Yeux de Maurice Richard. Une histoire culturelle, Montréal, Fides, 2006, 279 p. 18 illustrations en couleurs; 24 illustrations en noir et blanc. Nouvelle édition, revue et augmentée : Montréal, Fides, 2008, 312 p. 18 illustrations en couleurs; 24 illustrations en noir et blanc. Préface d’Antoine Del Busso. Traduction : The Rocket. A Cultural History of Maurice Richard, Vancouver, Toronto et Berkeley, Greystone Books, D&M Publishers Inc., 2009, 304 p. 26 illustrations en couleurs; 27 illustrations en noir et blanc. Traduction de Fred A. Reed. Préface de Roy MacGregor. Postface de Jean Béliveau. Édition de poche : Montréal, Fides, coll. «Biblio-Fides», 2012, 312 p. 42 illustrations en noir et blanc. Préface de Guylaine Girard.
Raymond, Sébastien, Bâton élevé, mises en échec verbales et slapshots philosophiques, Montréal, Les 400 coups, 2012, [n. p.]. Ill.