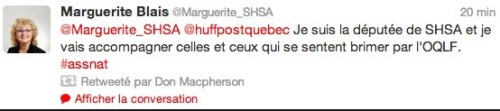«Le Québec est un vaste
camp de concertation,
ai-je déjà entendu.»
(@Ant_Robitaille)
Les 25 et 26 février, le gouvernement du Québec tiendra un Sommet sur l’enseignement supérieur. Pour qui ne le saurait pas, le sommet est un art québécois.
En 2004, voici ce qu’écrivaient l’Oreille tendue et son comparse dans leur Dictionnaire québécois instantané à l’article «sommet» :
1. Vie courante. Voir top.
2. Politique. Réunion de gens qui ont un caractère physique ou idéologique commun. Les conclusions d’un sommet sont toujours préparées à l’avance par son organisateur, lequel est le plus souvent un ministère, un lobby ou un gouvernement. Variante du festival et du salon. De l’animation, de la francophonie, de la nordicité, des Amériques, des légendes, des régions, du Québec et de la jeunesse, sur l’économie et l’emploi. Voir audiences, carrefour, chantier, coalition, comité, commission, concertation, consensus, consultation, états généraux, forum, partenaires sociaux, rencontre, suivi et table.
[Remarque] 1. De moins en moins pris au sérieux. «Le sommet des corridors. Les discussions formelles ne sont que la pointe de l’iceberg» (la Presse, 25 février 2000). «L’utilité des sommets reste à démontrer» (le Devoir, 11 avril 2001). «Tiens tiens, un Sommet…» (la Presse, 17 avril 2001) «Montréal, ville aux 100 sommets» (la Presse, 13 mars 2002). «Le sommet du tricot» (la Presse, 26 mai 2002). «Le sommet du sac de couchage» (la Presse, 25 mai 2002). «Le sommet des listes d’épicerie» (le Devoir, 31 mai 2002). «Le sommet des bonnes intentions» (le Devoir, 8-9 juin 2002).
[Remarque] 2. S’exporte, néanmoins. «Un sommet extraordinaire des primats anglicans sur l’homosexualité» (le Devoir, 9-10 août 2003) (p. 207).
En 2005, dans un article pour la revue française Cités, l’Oreille évoquait de nouveau cette pratique :
Le Québécois, surtout s’il est pure laine, est grégaire. La moindre question sociale est-elle soulevée, qu’il convoque des audiences, un carrefour, un chantier, un comité, une commission, des états généraux, un forum, un groupe (~-conseil, ~ de discussion, ~ de travail), une rencontre ou un sommet. Son meuble favori est la table : d’aménagement, de concertation, de convergence, de prévention, de suivi, ronde. S’il veut s’amuser, rien de mieux qu’un festival, voire des festiveaux (orthographe recommandée). Dans les régions ou le 450, il célèbre la faune et la flore, l’eau et le feu, le pétrole et le sirop d’érable, la tomate comme le camion. Autour du Plateau, il se croit plus raffiné et préfère le théâtre (des Amériques), le jazz (musique à la définition extensible, de Ray Charles à Luis Mariano), l’humour (dit Juste pour rire). Il ne trompe personne en déguisant son festival en biennale, en classique, en défi, en féria, en fête, en foire, en international, en rendez-vous ou en virée. Plus on y est de fous, plus on rit (p. 239-240).
Il n’y a donc pas lieu de s’étonner du fait que le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois ait décrété un sommet à la suite du printemps érable.
Une chose reste à vérifier. En 2004, nous écrivions : «Les conclusions d’un sommet sont toujours préparées à l’avance par son organisateur […].» Vu l’état de non-organisation du sommet des prochains jours, rien n’est moins sûr. On verra.
[Complément du 25 février 2013]
Parfois, l’Oreille se demande si elle n’exagère pas un brin. Puis elle ouvre le Devoir et elle lit : «Pour un chantier post-sommet sur la gratuité» (25 février 2013, p. A7). Cela la rassure, en quelque sorte.
Références
Melançon, Benoît, en collaboration avec Pierre Popovic, Dictionnaire québécois instantané, Montréal, Fides, 2004 (deuxième édition, revue, corrigée et full upgradée), 234 p. Illustrations de Philippe Beha. Édition de poche : Montréal, Fides, coll. «Biblio-Fides», 2019, 234 p.
Melançon, Benoît, «La glande grammaticale suivi d’un Petit lexique (surtout) montréalais», Cités. Philosophie. Politique. Histoire, 23, 2005, p. 233-241. https://doi.org/10.3917/cite.023.0233; https://doi.org/10.3917/cite.023.0238